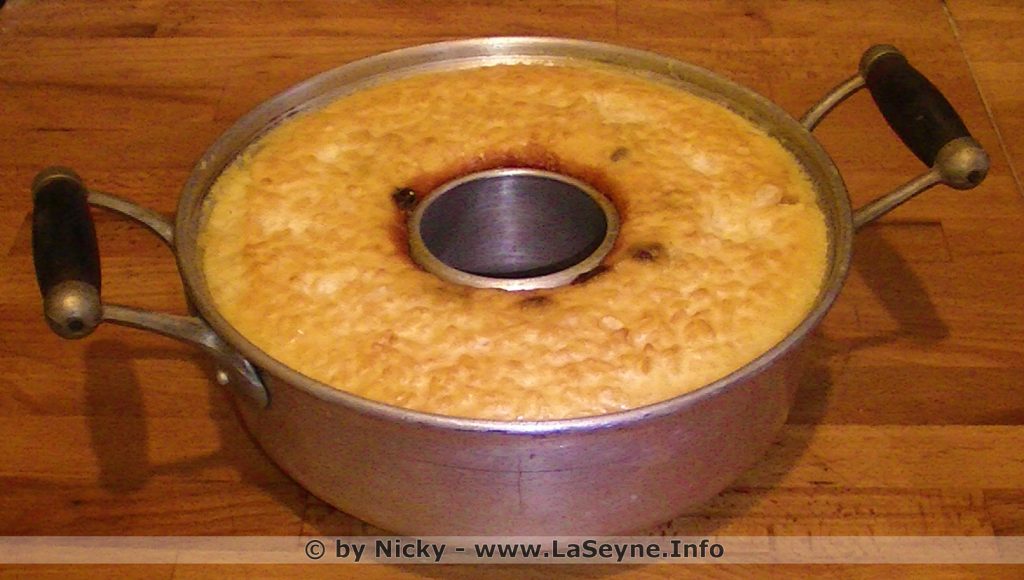Walther Rauff, le nazi que le monde a protégé : de l’invention du meurtre industriel à la Tunisie occupée, puis au Chili de Pinochet
Né en 1906 à Köthen, Walther Julius Rauff aurait pu rester un nom oublié parmi tant d’autres officiers nazis. Pourtant, derrière cette façade banale, se cache l’un des architectes anonymes de la mort de masse. Cet ancien officier de la marine allemande devenu membre du SD – le service de renseignement de la SS – joua un rôle central dans la mise en œuvre de la “solution finale”. Son nom reste associé à une invention macabre : les camions à gaz mobiles, ces véhicules équipés de systèmes d’échappement détournés, conçus pour tuer par asphyxie des milliers de victimes, enfermées à l’arrière. Ces engins de mort, ancêtres des chambres à gaz fixes, firent plus de 200 000 victimes en Europe de l’Est.
Envoyé en Tunisie : l’extension coloniale de la barbarie
Fin 1942, l’armée allemande occupe la Tunisie avec le soutien du régime de Vichy. Walther Rauff y est envoyé pour diriger une unité spéciale du SD. Sa mission : appliquer sur le sol africain les méthodes d’extermination déjà testées en Europe. La Tunisie, bien que géographiquement éloignée du centre de la machine nazie, ne fut pas épargnée par le programme génocidaire. À preuve : la conférence de Wannsee, tenue en janvier 1942 à Berlin, incluait dans ses décomptes les Juifs d’Afrique du Nord, estimés à plusieurs centaines de milliers. Sur la carte murale de la villa de Wannsee, le chiffre de 700 000 Juifs était inscrit sous la mention “France et Afrique du Nord”.
C’est dans ce cadre que Rauff organisa la rafle de Tunis en décembre 1942, ordonnant la confiscation des postes de radio – pour empêcher l’écoute de Radio Londres – ainsi que l’arrestation d’otages parmi les responsables communautaires. Au total, plus de 5 000 Juifs tunisiens furent déportés dans 32 camps de travail forcé, répartis sur tout le territoire, notamment près des ports stratégiques comme Bizerte, cible récurrente des bombardements alliés. Des témoignages d’époque décrivent les conditions de vie effroyables dans ces camps : privations, maladies, tortures. L’enfer, en version nord-africaine.
Des figures de résistance face à la machine SS
Face à cette brutalité, certains osèrent défier l’envoyé d’Hitler. L’avocat Paul Ghez, figure respectée de la communauté juive tunisienne, se dressa courageusement contre Rauff, tout comme le Grand Rabbin Belaïche, symbole d’une dignité spirituelle indestructible.
Des réseaux clandestins d’aide et de soutien se formèrent, dans les synagogues comme dans les ruelles du vieux Tunis. Des femmes comme Louise Hannon entrèrent en résistance. La communauté juive tunisienne, forte de 75 000 âmes, traversa l’occupation avec une résilience admirable, bien que meurtrie.
La Tunisie fut sauvée de l’anéantissement total – tel que celui de la communauté de Salonique, exterminée à 97 % – par un concours de circonstances historiques : la défaite de Rommel à El Alamein, la victoire soviétique à Stalingrad, et la mer Méditerranée comme dernier rempart naturel. En mai 1943, les Alliés libèrent Tunis dans une liesse que décrira l’écrivain André Gide dans un journal parisien.
Un bourreau qui n’a jamais payé
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Après la guerre, Rauff est arrêté par les Alliés en Italie, mais il s’évade, aidé par des réseaux catholiques, notamment par le célèbre évêque Alois Hudal, bien connu pour avoir protégé plusieurs criminels nazis.
Rauff trouve refuge en Syrie, où il devient – ironie tragique – conseiller militaire du président syrien Husni al-Za’im. Lors du renversement de ce dernier, il fuit à nouveau, transite par l’Équateur, l’Argentine, l’Uruguay, pour finalement s’installer au Chili en 1958.
C’est là qu’il échappe à l’Histoire – et à la justice. Engagé par le renseignement ouest-allemand (BND), puis protégé par la dictature de Pinochet, Rauff aurait collaboré avec la sinistre DINA, la police politique du régime, impliquée dans la torture, les disparitions et les exécutions sommaires. Il forma le personnel des centres de détention secrets, selon certaines sources, et participa aux stratégies de répression.
Pas d’Eichmann pour la Tunisie
Pourquoi cet homme ne fut-il jamais capturé par le Mossad, comme Adolf Eichmann en Argentine ? Interrogés sur le sujet, Teddy Kollek, Asher Ben Natan et Shimon Peres répondirent sans détour : « À cette époque, seule la sécurité d’Israël nous importait. » Un choix stratégique qui laissa un bourreau vivre en paix, jusqu’à sa mort, en 1984, dans un lit d’hôpital chilien.
Hamous Zana : le chant de la survie
Et pourtant, malgré l’horreur, malgré la peur et les humiliations, la communauté juive tunisienne survécut. À Tunis, un chant populaire en judéo-arabe célèbre encore cette résistance : “Hamous Zana Ya Louled”, dont le refrain, plein de force, fut repris dans les maisons, les synagogues, les mariages. Le mot “Hamous”, selon certains témoignages, aurait même été utilisé comme nom de code pour la libération imminente.
![]()